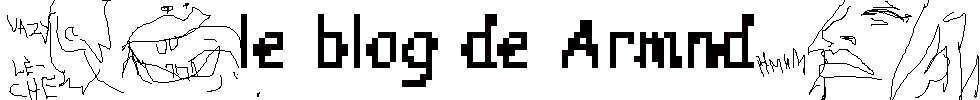Beaucoup de choses peuvent advenir dans une même journée. Beaucoup d'horribles choses. Aujourd'hui par exemple, le ciel grisâtre ne suffisait pas. Le pluie, et le vent qui retournait mon parapluie ne suffisaient pas non plus. L'horrible interrogation d'Histoire qui me fit effectivement m'interroger quant à mon avenir scolaire ne parachevait pas le tout. Non. Car aujourd'hui, dans le bus, j'ai vu quelque chose de bien pire encore.
J'étais alors tout joyeux, tout candide, tout bon enfant, quand je faisais quelques pas mouillés dans le couloir de l'autobus six en essayant de passer ma carte d'abonnement devant le bipeur et le chauffeur consterné tout en fermant mon parapluie, pendant que l'autre main était affairée à gratter mon genou gauche. J'étais tout souriant, à ce moment-là, rentrant chez moi, ne me doutant pas pour un sou de ce qui allait m'arriver. D'une démarche toujours aussi amène, je me précipitai donc vers le fond du bus pour doter mon derrière d'une quelconque place assise fort appropriée à ma fatigue soudaine. Je m'assayais tranquillement, non sans chercher longtemps une petite place au sol pour y mettre mon parapluie mouillé sans gêner les passagers, car je suis poli, quelquefois. De même, je plaçai mon sac à dos à mes pieds, et mon appareil photo sur mes genoux ; me voilà paré à faire un confortable voyage de vingt minutes.
Mes yeux vagabondent – oui, je passe au présent de narration impunément, et alors ? Si ça vous plaît pas regardez ailleurs, nan mais de quoi je me mêle – mes yeux vagabondent, je disais donc, passent d'une focale à l'autre, d'autre sujet à l'un, d'un détail à l'autre, d'autre lumière à l'une. Puis, par le hasard le moins probable, je remarque que la passagère du siège d'en face à gauche tient un livre ouvert entre les mains. Elle ne le lit pas, mais elle le tient. Son regard est dirigé vers le décor de ville qui passe, à travers la fenêtre, mais elle le tient. Curieux, j'essaye de déchiffrer les grosses inscription de la tranche – car le livre est assez épais. Je distingue vaguement un nom d'auteur... COR... CORW... CORNWELL... Et son prénom ?... Ça me dit quelque chose, Cornwell. Son prénom, n'est-ce pas Patrick ?... P... Patricia ! Patricia CORNWELL, y a écrit. Titre écrit trop petit, indéchiffrable. Merde, oui, Patricia Cornwell, la best-selleuse amérloque. Bon. La passagère du siège d'en face à gauche lit du Patricia Cornwell. Naturellement, je me dis : peu importe. Comme tout le monde, comme tout le temps. Je n'y fais plus attention, j'oublie. C'était un détail parmi tant d'autres dans une journée de merde. Bien. Mon regard se fait à nouveau impertinent, négligent, errant, lent.
Jusqu'à ce que cette même passagère décroche son téléphone portable. Elle y répond quelque chose comme : “Oui... j'arrive bientôt, je suis dans le bus là...”. Bref, une banalité qui n'attire l'attention que parce qu'elle constitue une exception dans l'environnement sonore monotone du bus. Elle raccroche donc ; je la regarde toujours, son visage m'intrigue, il est assez joli, mais je viens de remarquer que sa mâchoire est légèrement décentrée. Mais jusqu'ici, ce trajet de bus n'avait été qu'une succession d'évènements bien habituels dans le milieu des transportés en commun. Lisez-bien, chez lecteur, le pire est à venir.
Mon regard est donc toujours posé sur cette femme de la trentaine. Le bus va pour s'arrêter, nous sommes au milieu de l'avenue de Toulouse. La passagère semble alertée, le bus est vraisemblablement en train d'atteindre sa destination. Moi, je suis encore assis, mon arrêt est bien plus loin. Je la vois ranger son livre dans son immonde sac à mains, et c'est alors que, pendant cette opération, je distingue ses doigts qui – lisez bien, c'est là – d'un geste vif et désintéressé, je dirai même désinvolte, provoquant, CORNENT L'ANGLE SUPÉRIEUR DROIT DE LA PAGE où sa lecture s'était arrêtée.
Nan mais rendez-vous compte.
Sous mes yeux. Sous les yeux d'enfants, car il y en avait, dans le bus. Et sous les yeux de vieillards, et peut-être même de femmes enceintes. Qui sait.
À la pensée fugace qui traverse mon esprit, et qui veut que je décale sa mâchoire de quelques centimètres supplémentaires, succède une autre bien plus raisonnable, qui me calme : elle a le droit. Si, elle a le droit, c'est son livre. Je ne le lirai jamais, si l'on ne m'y oblige pas. Elle ne porte tort qu'à elle même.
Mais merde, non ! Cette deuxième pensée est trop facile. MERDE ! Corner les pages, c'est porter une atteinte grave à l'humanité toute entière, c'est retourner le couteau dans la plaie des lacunes culturelles françaises, c'est surinfecter le furoncle suitant des perversions capitalistes !
Personne ne lui a donc jamais dit ? Personne, personne ne l'a donc jamais engueulée, quand elle était gosse, en surprenant ce geste immonde et malheureux ? Que deviennent les Hommes ? Ses parents se sont peut-être même délibérément placés à l'origine de ce comportement infâme ; qui sait de quoi le monde est capable, de nos jours ?
Je parais bien intolérant, certes, mais je l'aurais peut-être excusée, si ç'avait été du Jarry ou du Vian ou du Rimbaud, qu'elle avait corné. J'aurais peut-être même salué son extravagante audace, car je l'aurais comprise comme volontaire, comme pensée, comme idéologique, comme raisonnable dans un certain sens ; bref comme explicable. Mais considérez-donc la répugnance de cette habitude, lorsqu'elle est prise sur des bouquins de Cornwell ! Pouvez-vous imaginer plus de trois pages d'un Cornwell se faire corner par une trentenaire surmaquillée, sans ciller ? J'en doute, chers lecteurs. Surtout que, d'après ce que me suggérait son physique, cette femme travaille certainement dans l'administration.
Méfiez-vous donc. Méfiez-vous de la ménagère corneuse de pages. On ne sait jamais, peut-être un jour tomberez-vous sur un de ces individus fauteurs de trouble, déguisé en épouse idéale, ou en belle-soeur terriblement sympathique. Il vous faudra être vigilant, chers lecteurs, et observer le moindre de ses gestes. Et si par malheur vous vous rendez compte, après douze ans de mariage, qu'il se trouve un Patricia Cornwell corné dans votre bibliothèque, fuyez. Loin.
Très loin.